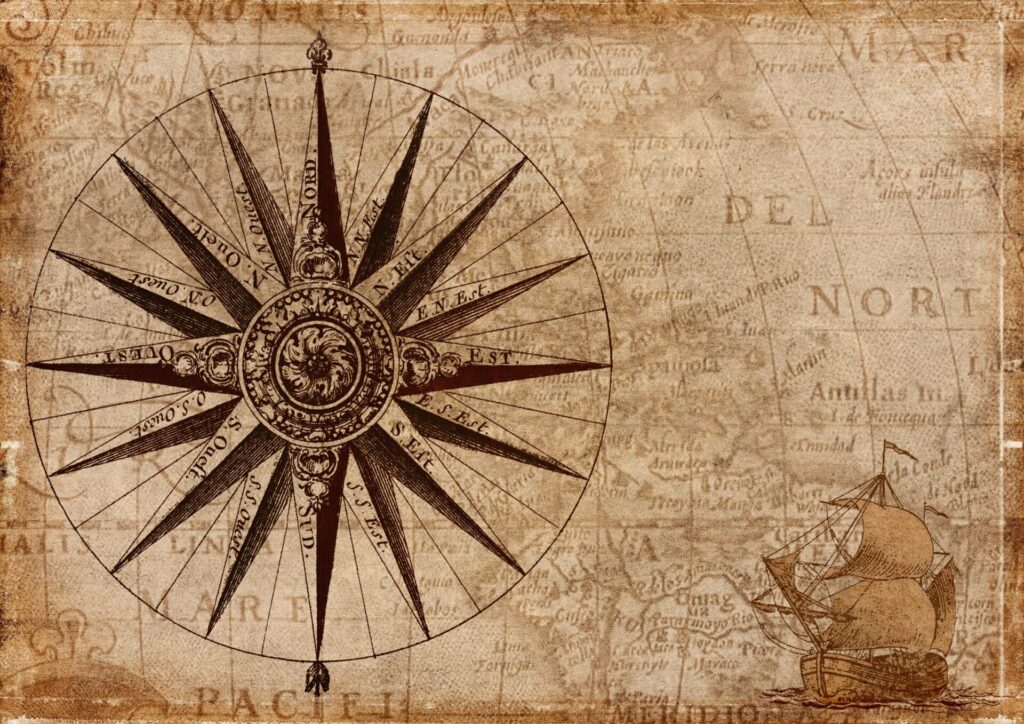[Cet entretien a été publié initialement sur le site de la Fondation du Collège de France]
Le Pr Patrick Boucheron, chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe siècles), décrypte les leçons que l’histoire peut apporter face à la crise écologique. Il souligne aussi l’importance du dialogue entre les sciences exactes et humaines et sociales pour remettre en cause ses certitudes et se donner la capacité d’agir. Interview.
L’initiative Avenir Commun Durable a pour ambition de saisir les enjeux environnementaux qui nous attendent dans toute leur complexité scientifique, technologique et sociétale. En tant qu’historien, quel regard portez-vous sur la crise climatique et les enjeux de la transition énergétique ?
Il me faut d’abord admettre que je ne suis, en aucune manière, spécialiste des questions environnementales, et encore moins du changement climatique ou de la transition énergétique. Le regard que je porte sur ces questions n’est donc pas expert. Il n’en est pas moins intéressé, ne serait-ce que par la question même des rapports entre expertise et débat démocratique. D’une manière générale, c’est toute l’écriture de l’histoire — et pas seulement celle du climat — qui se trouve bouleversée par cette crise, et l’ambition consiste à la rendre contemporaine de ses enjeux épistémologiques. Dans le cas des politiques énergétiques, le livre majeur de Timothy Mitchell, Carbon Democracy (traduit en français en 2013) a fort bien montré la nature politique des choix industriels des XIXe et XXe siècles, mais des travaux plus récents étendent à des périodes plus anciennes ces nouveaux questionnements.
Comment notre connaissance du passé peut-elle influencer notre perception de l’avenir, de nos actes futurs ?
D’abord en rappelant une évidence : l’histoire des sociétés humaines est celle d’une constante adaptation aux contraintes environnementales ; elle offre en cela un trésor d’expériences que l’on aurait tort de négliger au nom d’une conception trop technocratique de la science. On objectera peut-être qu’une des spécificités de notre temps consiste précisément dans la reconnaissance du rôle de l’industrie humaine dans le changement climatique, et qu’il a fallu un long et difficile travail de prise de conscience pour en prendre la pleine mesure, travail politique et par conséquent conflictuel. Or le livre récent de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les révoltes du ciel (2020) montre que cette conscience du rôle des décisions sociales sur le changement climatique fut beaucoup plus précoce qu’on ne le pense et, même si elle ne se fondait pas sur une compréhension scientifique de ses mécanismes physiques, suscitait une politisation du débat social sur le climat, depuis le XVe siècle au moins — c’est vrai notamment pour la question de la déforestation dans les sociétés agraires. L’histoire n’est pas une école de la fatalité. Au contraire, elle permet de puiser dans le passé des ressources pour élargir notre conception politique de la capacité d’agir.
Par son ampleur, sa fulgurance mais aussi ses causes et ses conséquences, le réchauffement climatique auquel nous faisons face aujourd’hui est inédit dans l’histoire des sociétés humaines. Face à la tentation de chercher des solutions – et peut-être un refuge – dans le passé, n’y a-t-il pas un risque d’induire une vision biaisée du présent ?
Vous avez raison, il y a quelque chose de spécifique à la brutalité de la crise actuelle, et c’est pourquoi la notion d’adaptation n’est pas suffisante pour en rendre compte. Contre la tentation actuelle de la collapsologie, il convient de réarmer la notion même de transition, en précisant que cette transition est à venir. Si les recherches actuelles en sciences sociales sur la responsabilité éventuelle de groupes de pression dans la fabrique de l’ignorance qui aurait retardé la compréhension des causes anthropiques du réchauffement climatique me semblent parfaitement légitimes, elles ne doivent pas nécessairement déboucher sur une histoire des occasions manquées, cherchant dans le passé récent le moment où nous aurions pu ou dû agir (comme le fait Nathaniel Rich dans Perdre la Terre, un livre important mais discutable, traduit en français en 2019). On pourrait plaider pour un catastrophisme éclairé, qui tient compte du paradoxe bien connu développé par le philosophe Hans Jonas : on ne prophétise pas la fin des temps pour la précipiter, mais pour éviter qu’elle arrive.
Face à ce défi de taille, quelle articulation peut-il exister entre les sciences dites « naturelles » et les sciences humaines et sociales ?
C’est un défi, comme vous le dites, car la notion même d’anthropocène oblige à desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux. Si l’espèce humaine devient une force géologique, le partage des savoirs né de la révolution scientifique du XVIIe siècle s’en trouve bouleversé. Dans mes recherches actuelles sur la peste noire (1347-1352), je considère l’histoire de l’épidémie — dont on sait aujourd’hui qu’elle a, sinon des causes, du moins des conditions environnementales et climatiques — comme un laboratoire d’interdisciplinarité. Elle élargit le domaine de l’histoire des hommes en l’intégrant dans le monde des vivants (puisqu’il faut comprendre le saut d’espèces) mais aussi, plus globalement, de son cadre environnemental. Elle en multiplie aussi les échelles, depuis la microbiologie et la paléogénétique de l’agent pathogène jusqu’aux mécanismes cosmiques précipitant les changements climatiques qui font sortir ledit agent pathogène (Yersinia pestis en l’occurrence) de ses réservoirs naturels. Et le tout en ne perdant jamais de vue le questionnaire de l’histoire des hommes face aux changements sociaux, reposant sur de nouvelles bases les questions très classiques de la rupture et de la continuité, de l’adaptation et de la transition.
Cette articulation sciences « naturelles » et sciences humaines et sociales sera mise en pratique à l’occasion du colloque « Changement climatique : adaptation ou transition » du 17 novembre prochain, pouvez-vous nous en dire plus ?
Ce colloque vise précisément à poser, à grande échelle et dans une perspective résolument transdisciplinaire, la grande question que je viens d’évoquer : celle de la causalité. Il s’agit bien d’éclairer le débat public par un raisonnement scientifique qui affirme et assume clairement son régime de vérité. Mais précisément : la valeur de vérité réside dans le raisonnement davantage que dans l’assertion. Voici pourquoi nous avons pris le parti de l’échange : sur quatre questions cruciales, une conversation s’engagera entre deux chercheurs, conversation modérée par une journaliste scientifique. Ces quatre questions sont respectivement : le calcul du coût économique de la transition énergétique, la capacité des sociétés à le supporter sur la longue durée, l’apport de la compréhension biologique des pressions de sélection sur la capacité d’adaptation et le rôle du droit pour encadrer et faire advenir une justice climatique. Ainsi espérons-nous nous rendre utiles, moins en imposant une parole d’expertise qu’en proposant de placer la science devant la société.
Propos recueillis par Flavie Dubois-Mazeyrie